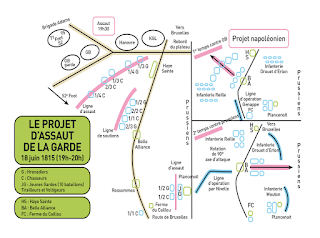En
pénétrant dans une zone de combat, le fantassin sait d’abord qu’il va évoluer
dans un paysage surréaliste et sinistre. Ernst Jünger parle d’un « désert calciné où le bombardement a
raboté toutes les inégalités du paysage, où les explosions des obus jaillissent
en gerbes hautes et denses comme les geysers dans les zones volcaniques
d’Islande [ …] une terre noire
et fissurée où stagne encore la vapeur brûlante des gaz asphyxiants […] Tout cela fait l’effet au premier coup d’œil
d’un paysage onirique qui, avec ses détails et ses invraisemblances, s’empare
des sens en un éclair, les fascine et les éblouit en même temps [1]». Jean Galtier-Boissière
décrit un village perdu dans le no man’s land : « C’est une vision d’infernal cauchemar, le lugubre décor de
quelque conte fantastique d’Edgar Poe. Ce ne sont pas des ruines : il n’y
a plus de maisons, plus de murs, plus de rues, plus de formes. Tout a été
pulvérisé, nivelé par le pilon. Souchez n’est plus qu’une dégoûtante bouillie
de bois, de pierres, d’ossements, concassés et pétris dans la boue [2]. »
La
zone de combat est elle-même nettement délimitée. Généralement, dans un assaut,
un fantassin ne reste en première ligne que sur quelques centaines de mètres,
entre deux ceintures de retranchements associant réseaux de barbelés, postes
avancés, nids de mitrailleuses et deux ou trois tranchées reliées par des
bretelles. Pendant les combats, cette zone de terre travaillée et modelée est
recouverte par « la voûte imposante de
nos projectiles qui recourbe très haut au-dessus de nous ses arcs
élancés » et, sous les obus, « le
sifflement multiple et venimeux des trajectoires tisse au-dessus de nos têtes
un filet à mailles serrées, dans un ressac brûlant qui, pareil au fameux feu
grégeois, nous entoure comme un élément homogène [1]. » A partir de 1916, le cloisonnement est accentué par les
barrages d’artillerie, en particulier le barrage roulant, « terrible muraille, haute comme une tour, qui dissimule les
profondeurs de l’espace derrière un rideau de terre jaillissante » et
qui précède les fantassins dans leur marche. En cachant les assaillants, le
barrage roulant angoisse le défenseur et fascine les assaillants qui se sentent
aspirés par ce mur d’obus qui bondit de cent mètres toutes les deux minutes.
Régulièrement,
le paysage est ponctué de fusées de couleurs variées, qui achèvent de donner un
caractère surréaliste à l’ensemble. L’air lui-même est imprégné d’un mélange
d’odeurs cadavériques, de terre remuée, de poudres diverses, de fumées
d’échappement de chars et de vapeurs empoisonnées. Cette « mer de lourdes vapeurs, de fumées et de poussière […] estompe, même à très courte distance, les
formes des gens et des choses [1]. »
Le
fantassin aguerri sait également, que dans ce monde, il ne rencontrera que peu
d’ennemis. Pour résister au feu de l’artillerie, les défenseurs sont tapis,
voire pelotonnés dans des trous. Les assaillants, de leur coté, font des bonds
rapides, d’entonnoir en entonnoir, le dos rond et le nez au sol, prêts à se
coucher immédiatement. L’observation, des deux cotés se fait, au ras du sol, au
milieu des poussières. Enfin, la peur induit plutôt des engagements à grande
distance, où les armes automatiques ont le beau rôle. De ce fait, le paysage de
la zone de mort apparaît vide. Un officier décrit ainsi son arrivée à
Verdun en 1916 : « C’est une
impression d’immensité et de désert. [...] Où sont-ils ? Où sont les nôtres ? Rien, on ne voit rien de
vivant. Seraient-ils tous morts, balayés par l’ouragan qui déferle sur eux
depuis quatre mois ? [...] Sur
ce pays désert et mort, une seule chose manifeste sa vie, c’est le canon [3]. » Pour le sergent Chenu, qui se prépare à partir à l’assaut : « L’ennemi ? Comme d’habitude,
nous ne le verrons pas. Ce seront des obus, des balles ; tout ou plus, au
loin, des silhouettes se dressant, s’absorbant dans le sol [4]. »
Le
fantassin sait, en revanche, qu’il rencontrera presque à coup sûr des
spectacles horribles. Le choc des premières visions de morts ou de blessés
graves est surmonté au moment de l’action par un blocage de la sensibilité,
puis par l’accoutumance. En 1918, lors d’une attaque, Jünger, combattant
aguerri, est gêné par un corps : « J’enjambe
le cadavre et trois pas plus loin l’événement s’est déjà effacé de ma mémoire [1]. » Mais certaines visions particulièrement horribles peuvent
encore bouleverser les vétérans. Le même Jünger, lors de la même offensive,
voit sa compagnie frappée par un obus de très gros calibre : « Ce que j’aperçois alors de ma petite
niche, de ce balcon d’où je plonge sur l’entonnoir béant comme sur une arène
effroyable, cela me transperce le cœur comme une lame glacée et me jette d’un
seul coup dans un désarroi total, me paralyse comme une apparition criarde dans
une vision de cauchemar […]Le cœur
voudrait écarter ce lui cette image et pourtant il enregistre tous ses détails [1]. » Jünger s’enfuit. Ces
visions refoulées de cadavres aux postures grotesques, les cris de soldats
mourant étouffés, les troupes entières fauchées resurgissent souvent dans
l’esprit des hommes, en particulier dans la période d’attente du combat.
Si
le champ de bataille apparaît souvent vide, il est, en revanche, bruyant, avec
un spectre des bruits qui va des cris de blessés à l’éclatement des obus en
passant par les sons variés des balles, les bruits de moteurs et de chenilles.
Comme le combattant voit peu d’ennemis et quasiment jamais de départs de coups,
il est donc obligé, le plus souvent, de se fier à son ouïe pour appréhender le
menaces. Avec le temps, il apprend à trier les sons dans le chaos.
Les
bruits les plus fréquents proviennent des balles de fusils et, surtout, de
mitrailleuses. Ces bruits sont beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît. La
balle, animée d’une vitesse initiale supérieure à celle du son, produit par son
choc dans l’air, un claquement, distinct de la détonation du départ et du
sifflement qui accompagne le projectile glissant sur sa trajectoire. Ce
claquement est le son le plus bruyant, c’est lui qui meuble essentiellement l’ambiance
du combat d’infanterie. Lors de la préparation d’un coup de main en 1918, le
lieutenant-colonel Armengaud, appuyé par un groupement de 84 mitrailleuses
tirant en tir indirect au-dessus de sa tête, n’entendait plus les barrages
d’artillerie, couverts par le bruit des claquements de balles [5]. De plus, au point de vue
psychologique, ces « bangs » supersoniques projettent leur son
de haut en bas et oppressent le soldat.
La
méconnaissance de ce phénomène peut avoir des conséquences graves. Le claquement,
que l’on entend en premier, peut être confondu avec la détonation de départ.
Les soldats inexpérimentés situent alors l’ennemi dans une mauvaise direction
et plus près qu’il n’est en réalité. Des unités ont même paniqué croyant être
débordées sur leurs arrières. Ces confusions sont à l’origine de multiples
légendes (fusils à deux détonations, mitrailleuses postées dans les arbres et
surtout les balles explosives). Un officier à la brigade de fusiliers marins,
explique la difficulté de faire comprendre cela à ses hommes : « Ils craignent le claquement de l’onde
de Mach. Je n’ai jamais pu réussir à leur donner une idée de ce phénomène. Ils
s’en tiennent à une explication simpliste : si le claquement désagréable
se produit au voisinage d’arbres ou de maisons, il résulte du choc de la balle
sur un obstacle, arbre ou mur ; s’il se produit en l’air…plus de doute
possible, c’est une balle explosive [6].»
L’origine
du tir d’une mitrailleuse est encore plus difficile car la succession de
claquements étouffe complètement les faibles détonations de départ. Une oreille
exercée, si le bruit de la bataille le lui permet, pourra déceler
éventuellement les chocs sonores très faibles des dernières balles tirées.
Elles seules indiquent la véritable direction de l’arme. Comme le plus souvent
les mitrailleuses tirent en flanquement par rapport à la cible, l’erreur la
plus courante est de situer la mitrailleuse devant soi, dans l’axe des
claquements. De plus, la mitrailleuse, au crépitement régulier et rythmé,
impressionne plus que les balles de fusils, « bruissements
d’insectes », en donnant l’impression « d’un mécanisme insensible comme une faucheuse automatique de vies
humaines propre à semer la mort avec une précision extrême [7] »
Le
claquement, peut être suivi d’un sifflement. Ce son surprend moins mais produit
une sensation désagréable. Il induit instinctivement un abaissement de tête, on
« salue », attitude vaine car le projectile est déjà loin. Les vieux
soldats apprennent à ne pas « saluer » mais savent que ce sifflement,
perceptible dans un court rayon autour de la balle, signifie de manière
certaine que l’on est pris sous le feu.
Pour
être complet, il faut ajouter les ricochets et les échos, en particulier en
milieu urbain ou dans les bois. Le son du claquement se répercute sur les murs
ou les arbres et déconcerte encore plus les hommes. Il faut également ajouter
un son beaucoup plus macabre : celui de l’impact sur les corps. Les balles
et éclats d’obus produisent un bruit assez sourd, mais qui peut devenir aiguë
lorsqu’ils sont déviés par un os.
A
partir de 1916, l’oreille du fantassin doit s’accoutumer également aux canons
d’infanterie, armes à tir tendu qui projettent à grande vitesse initiale des
petit obus, explosifs ou non, et surtout, aux grenades, à main ou par fusil et
mortier léger. Leur arrivée, souvent silencieuse ou précédée d’un léger bruit
(mortier), est cachée. Pour s’en parer, il faut observer le ciel en permanence,
ce qui suffit généralement à en éviter les effets. Les grenades dites
offensives, au seul effet moral, n’impressionnent guère les hommes aguerris qui
les reconnaissent vite à l’éclatement sec et l’absence de sifflements d’éclats.
Avec
les balles, l’environnement sonore est occupé par les obus. Les phénomènes sont
identiques à ceux des balles, en plus fort et avec un éclatement à l’arrivée.
La détonation de départ n’est pas toujours entendue par le fantassin à
cause de l’éloignement et du défilement des pièces. Le claquement n’a lieu que
lorsque la vitesse initiale de l’obus est supérieure à celle du son. Ce bruit
est assez loin de l’infanterie et son volume est atténué par la distance. Le
premier rôle est donc au sifflement et à l’éclatement.
Beaucoup
plus fort que celui de la balle, le sifflement annonce l’arrivée. « L’obus avant d’éclater, grince ou
jette dans les airs au cours de son trajet comme un long cri strident. Selon
qu’il est fusant ou percutant, selon son calibre, sa vitesse, la tension de la
trajectoire, le vacarme varie depuis le bruit de la sirène jusqu'au bruit de
ferraille d’un train rapide en marche. Tous les combattants avaient appris à
distinguer chacun des calibres des obus, depuis les 77 allemands jusqu'au 420,
par le seul ronflement, miaulement ou bruit particulier qui les caractérise.
Mais c’est au bruit de l’éclatement, au tonnerre de l’explosion que
réagissaient intensément les auditeurs : vibrations terrestres, poussées
aériennes, aspirations violentes, ajoutaient leurs effets psychologiques aux
milles réactions auditives que les éclats, le bruit de terre soulevée et des
cailloux projetés produisaient au même instant [7]. » Les effets de la
peur sont accrus par la surprise du fracas et les troubles respiratoires ou
circulatoires dus au souffle de l’explosion.
On
distingue trois types d’obus : les obus à balles (ou schrapnels) ont une détonation moins forte que l’obus explosif et
un rayon d’action plus restreint. Très utilisés au début de la guerre, ils ont
été rapidement délaissés car peu efficaces ; les obus explosifs
fusants produisent un gros volume sonore, intégralement répercuté dans
l’air. Ils sont difficiles à régler et leur efficacité reste limitée au
personnel ; les obus explosifs percutants sont les plus efficaces
grâce à la projection des éclats, un puissant effet moral qui agit à la
fois par la vue (geyser de terre, panaches de fumées et de poussières), l’ouïe
(fracas des explosions) et le système nerveux (secoué par le souffle et
l’ébranlement du sol). Ces obus, les plus utilisés, sont également les seuls à
avoir un effet matériel important contre les retranchements mais ils sont plus
ou moins neutralisés par l’enfouissement dans le sol avant d’éclater et il
existe de nombreux angles morts dans la gerbe d’éclats.
Les
obus de gros calibre sont reconnaissables au
« doux chuintement » de leur parcours assez lent. Au voisinage de
leur point de chute, les « gros » peuvent être vus en l’air, tombant
au sol comme de grosses pierres. Si les hommes sous abris ne craignent pas le
souffle et les éclats des obus, ils subissent de plein fouet l’ébranlement du
sol. Dans les abris bétonnés, le martèlement continu de la dalle par les obus
de gros calibre, que l’on n’entend pas venir, est une épreuve nerveuse
terrible. Le 23 octobre 1916, le fort de Douaumont est ainsi abandonné par sa
garnison allemande, terrorisée par les obus de 400 mm qui s’abattent toutes les
dix minutes.
Pour
le fantassin des tranchées, les obus constituent la principale menace. Les
hommes sont terrifiés par les mutilations qu’ils provoquent et par le sentiment
d’impuissance que l’on éprouve face à eux. « Sous
l’averse de fer et de feu on sent la même impuissance qu’en présence d’un
effroyable cataclysme de la nature. A quoi peuvent nous servir nos grenades et
nos petits fusils contre cette avalanche de terre et de mitraille ? A quoi
nous sert notre courage ? Un homme se défend-il contre le tremblement de
terre qui va l’engloutir ? Tire-t-on des coups de fusil sur un volcan qui
vomit sa lave enflammée [2] ? »
Outre
les éclats, l’explosion de l’obus produit un « souffle », en fait une
onde aérienne condensée à l’avant (compression de l’air) et dilatée à l’arrière
(raréfaction de l’air), dont la vitesse de propagation est supérieure à celle
du son. Ce souffle provoque de multiples commotions notamment cérébrales
(surdité, mutisme, anesthésie, tremblement, paralysie, etc...) et lésions
organiques sans plaies extérieures. La résistance au souffle en amplifie les
effets. Certains peuvent ainsi être soulevés de sol et être indemnes alors que
l’on cite, par exemple, le cas de mitrailleurs retrouvés morts figés devant
leur pièce par un effet de souffle agissant sur eux verticalement et qui n’a pu
être transformé en mouvement.
Les
énormes obus de l’artillerie de tranchées sont les plus impressionnants : « Une torpille, qui se balançait ne
l’air, tombe à quelques mètres : l’explosion est formidable. On sent ses
poumons éclater, sa tête se vider et le « coup de poing sur la
nuque », caractéristique du souffle. Des lueurs rouges, vertes, jaunes,
passent devant les yeux [8]. »
Lorsque
le bombardement se prolonge pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours,
les effets sur le système nerveux sont terribles. Jacques d’Arnoux décrit « un temps démesuré [pendant
lequel] nous écoutons les masses de fer
s’effondrer sur notre tranchée. Percutants et fusants, 105, 150, 210, tous les
calibres. Dans cette tempête d’écroulements, nous reconnaissons tout de suite
l’obus qui veut nous ensevelir. Dès que l’oreille distingue le funèbre
hululement, nous nous regardons avec angoisse. Tout crispés, tous
recroquevillés, nous plions sous la pesée du souffle. Nos casques se heurtent,
nous chancelons comme des hommes ivres [9].» Les pertes sont cependant
souvent moins importantes que ne laissent imaginer la vision de ces terribles Trommelfeuer ou « ouragans de
feu ». On estime ainsi à 1400 le nombre d’obus nécessaires pour tuer un
homme pendant la Grande guerre [10].
Néanmoins, l’artillerie cause les deux-tiers des pertes pendant la période la
guerre de tranchées.
A
partir de 1918, les fantassins doivent, de plus en plus faire, faire face à la
menace aérienne. Les bombes larguées sont peu précises mais impressionnantes
par leur « murmure
froufroutant » qui s’amplifie soudain, la forte explosion et le
sentiment d’être sans protection sous cette épée de Damoclès. Lorsque l’avion
attaque en rase mottes à la mitrailleuse, ce « bolide aérien qui fonce sur soi avec un grand rugissement de
moteur martelé par le claquement des balles [5] » produit un gros effet
moral mais les balles sont très dispersées et dès que le plafond d’attaque
remonte cet effet cesse.
Les
projectiles ne sont pas les seules agressions. Un tir d’artillerie, surtout à
partir de 1918, peut comprendre des obus à ypérite « ce gaz à l’odeur fade, inoffensive, l’ypérite qui brûle les
yeux, les poumons, l’ypérite qui tue après d’atroces souffrances ».
Cette menace terrifie les poilus qui « passent
le groin [le masque], serrant les tresses à s’en meurtrir, tâtant du doigt s’il
s’applique bien partout […] Leur
attention est tout entière au clic-clac du clapet, et, pour le contraindre à
fonctionner, ils respirent à grands coups, la poitrine oppressé [11]»,
exercice rendu souvent difficile par l’essoufflement du à la peur ou l’effort
physique. Le port d’équipements de protection accentue encore la sensation
d’isolement du soldat, amoindrit ses capacités à faire face aux menaces et donc
sa confiance en lui.
L’agression
peut également venir d’« en bas » par les mines, sapes et pièges de
toute sorte. Et, surtout à partir de juin 1918, le champ de bataille des
« grandes affaires » est traversé de chars qui broient les obstacles,
avancent à grand bruit de moteur et de chenilles sur le fantassin sans craindre
ses projectiles.
Dans
les moments de grands combats, la polyphonie qui règne sur le champ de
bataille agit comme un anesthésique face à la multiplicité des menaces. Selon
le lieutenant–colonel Armengaud, « ce
tonnerre continu absorbe les sifflements, atténue les claquements et les
éclatements, ne permet que difficilement de distinguer le projectile dangereux
des autres. Dans une attaque à grand orchestre, l’homme ne « salue »
guère les balles ou les éclats, ne s’aplatit pas sous les obus qui pleuvent
autour de lui. Et s’il marche à l’objectif avec crânerie, c’est en partie à sa
surdité passagère qu’il le doit [5]. »
Il
est impossible de pénétrer dans un tel univers sans éprouver une peur intense.
Pour Jean Norton-Cru, poilu « tous
les soldats sans exception ont peur et la grande majorité fait preuve d’un
courage admirable en faisant ce qu’il faut faire en dépit de la peur. Nous
avons peur parce que nous sommes des hommes et c’est la peur qui a préservé la
vie de nous tous qui survivons. Sans peur nous n’aurions pas vécu vingt-quatre
heures en première ligne ; nous aurions commis tant d’imprudences par
inattention que nous aurions vite reçu la balle qui guette l’inconscient [12] »
 Tout aurait été dit sur la campagne de 1815 et son point d’orgue,
la bataille de Waterloo, qui décida du sort de Napoléon et du 1er
Empire.
Tout aurait été dit sur la campagne de 1815 et son point d’orgue,
la bataille de Waterloo, qui décida du sort de Napoléon et du 1er
Empire.