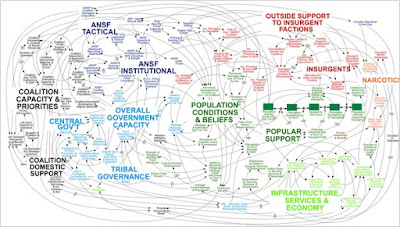Adapté de l'article publié dans Défense et sécurité internationale n°142, juillet-août 2019
En 1972, une force expéditionnaire
française d’environ 2 000 hommes quittait le territoire tchadien après
l’avoir sécurisé. Huit ans plus tard, une autre force française de même ampleur
se repliait à nouveau du Tchad, mais avec le sentiment cette fois de ne pas
avoir eu de prise sur les événements. La différence entre les deux ? Dans le
premier cas, le problème stratégique était à « deux corps », dans le second, il
était passé à « trois corps ». De « compliquée » la situation était
devenue « complexe » et cela changeait tout.
Dans la matrice
Une opération militaire simple est une
action dont les relations de cause à effet y sont parfaitement connues. Une
fois le problème bien identifié, il suffit d’appliquer la procédure
correspondante pour le résoudre. Au début des années 1960, le dispositif
militaire français en Afrique est essentiellement une force de contre-coup
d’État. Pourvu qu’il soit rapide, le déploiement d’une compagnie française
suffit à coup sûr à empêcher le renversement du pouvoir en place. La seule
inconnue est alors la décision du président de la République française d’agir
ou non. L’engagement du 2e Régiment étranger de parachutistes à Kolwezi en
mai 1978 est un bon exemple d’opération simple, ce qui ne veut évidemment pas
dire sans danger pour ceux qui l’exécutent.
Action courte, claire et au succès assuré,
l’opération simple a évidemment la préférence des décideurs politiques. Elle
est cependant rare, car il y a toujours des intelligences en face qui vont
s’efforcer qu’il n’en soit pas ainsi. Une erreur courante est alors d’annoncer
une opération simple, afin qu’elle passe mieux auprès de l’opinion publique et
parce qu’on le souhaite ainsi, alors qu’elle ne l’est pas. On peut même
annoncer à l’avance la fin de l’engagement, comme lors de l’intervention
française en République centrafricaine en décembre 2013. C’est généralement
hasardeux. L’opération de stabilisation en Centrafrique aura duré finalement
six fois plus longtemps qu’annoncé et pour un résultat plus mitigé.
Les problèmes opérationnels relèvent
logiquement beaucoup plus souvent du « compliqué » que du « simple ». Le
compliqué est un champ où les paramètres, en particulier les modes d’action de
l’ennemi, sont assez bien connus ainsi que, normalement, ses propres
possibilités. Obéissant à un jeu à somme nulle, les résultats des confrontations
des uns et des autres peuvent être évalués selon une matrice à peu près claire.
Si les paramètres ont bien été identifiés, les choix deviennent relativement
faciles à faire.
 L’opération Limousin est
déclenchée en 1969 avec pour objet de restaurer l’autorité de l’État tchadien
face à une opposition armée regroupée dans le Front de libération nationale
(Frolinat). Les acteurs amis et ennemis sont peu nombreux, avec des objectifs
et des moyens pour les atteindre bien connus, tandis que les influences
extérieures sont limitées. Les relations de cause à effet sont identifiables,
même si elles sont diverses. Nous restons surtout là dans une confrontation
duale, un « problème à deux corps » pour employer un terme de physique. Il est
donc possible d’établir une matrice en deux dimensions, avec peu d’entrées et
un nombre limité de situations relativement prévisibles.
L’opération Limousin est
déclenchée en 1969 avec pour objet de restaurer l’autorité de l’État tchadien
face à une opposition armée regroupée dans le Front de libération nationale
(Frolinat). Les acteurs amis et ennemis sont peu nombreux, avec des objectifs
et des moyens pour les atteindre bien connus, tandis que les influences
extérieures sont limitées. Les relations de cause à effet sont identifiables,
même si elles sont diverses. Nous restons surtout là dans une confrontation
duale, un « problème à deux corps » pour employer un terme de physique. Il est
donc possible d’établir une matrice en deux dimensions, avec peu d’entrées et
un nombre limité de situations relativement prévisibles.
Dans l’ensemble, la guerre se déroule
pendant trois ans dans le cadre de cette matrice, du niveau stratégique jusqu’à
celui des batailles. Cela n’empêche pas les erreurs. La campagne Bison au
début de 1970 au nord du Tchad est un échec et le 11 octobre de la même
année, les Français subissent à Bedo une embuscade qui occasionne en
quelques heures le quart des pertes de toute la guerre et fait la une des
journaux. Dans le cas de Bison, les possibilités de l’ennemi
avaient été mal évaluées. Elles ont été mieux connues à l’issue et ont abouti
au renoncement à pacifier la région du Borkou-Ennedi-Tibesti (BET). Dans
celui de Bedo, les possibilités de l’ennemi avaient été bien évaluées hormis sa
faculté à commettre des erreurs. Le lieu du combat n’était pas du tout
favorable à une embuscade, ce qui a abouti à surprendre les Français, mais au
bout du compte aussi à piéger les rebelles dans un endroit d’où ils n’ont pu se
replier sans subir de très lourdes pertes.
Pour autant, lorsque l’opération Limousin se
termine à l’été 1972, le résultat est conforme à ce qui était prévisible,
comme s’il y avait une élasticité des problèmes compliqués qui les ramenait
toujours vers les « inconnues connues ». Si on ne peut prévoir le résultat d’un
seul lancer de dés, on connaît tous les résultats possibles et sur la longue
durée et de nombreux lancers on peut évaluer à peu près leur répartition. On
peut établir une stratégie cohérente à long terme.
Les guerres mosaïques
Après la préférence excessive pour le
simple, une autre erreur commune est de croire qu’une opération à venir sera du
même niveau de complexité que la précédente. Lorsque la France s’engage à nouveau
au Tchad en février 1978, les choses semblent être proches de la situation de
1969. Une nouvelle entité politico-militaire est bien apparue avec les Forces
armées du nord (FAN) d’Hissène Habré, mais elle est alliée au gouvernement du
général Malloum contre le Frolinat de Goukouni Oueddei. On reste donc dans un
problème « à deux corps » et lorsque le Frolinat menace à nouveau la
capitale, il est sévèrement battu par les forces françaises. La situation
semble alors se stabiliser avant de basculer en février 1979 lorsque Hissène
Habré se détache de Malloum et l’affronte au cœur même de la capitale, avec
l’aide de Goukouni Oueddei. Le problème est devenu à « trois corps », et même
neuf si on inclut les factions moins importantes qui se sont installées dans certaines
zones du pays ainsi que la Libye qui a annexé la bande d’Aouzou.
La situation n’est alors plus compliquée,
mais complexe. Le nombre de situations possibles dans une matrice à n
dimensions devient beaucoup trop important pour être gérable. Les effets des
actions ne peuvent plus être prévus correctement car le contexte stratégique n’est
plus à somme nulle. Une victoire tactique peut affaiblir un camp ennemi, mais
renforcer un autre. Une série de victoires rendant un camp trop fort peut
inciter à des retournements d’alliance de ses alliés-rivaux. Ce genre de conflit a
alors tendance à durer jusqu’à ce qu’un adversaire dispose enfin d’une masse
critique suffisante pour s’imposer à tous les autres, comme le royaume de Qin
en Chine au IIIe siècle av. J.-C., ou que la lassitude s’empare de tous et
que la situation soit gelée et/ou le pouvoir partagé.
Au milieu de l’imbroglio tchadien, la
France aurait pu aider à la constitution de cette masse critique en choisissant
un camp. Elle a préféré tenter de stabiliser la situation en s’interposant
et en jouant les arbitres. Des « gouvernements d’union nationale » se sont mis
en place réunissant tous les leaders de factions avant de se scinder à nouveau.
En désespoir de cause, la France s’est retirée militairement du Tchad en 1980.
Il est toujours dangereux de s’introduire
dans une « guerre mosaïque », c’est-à-dire à plusieurs acteurs concurrents.
Après l’échec au Tchad, la France renouvelle pourtant l’expérience au Liban en
proie à la guerre civile. En 1982, lorsque l’armée israélienne pénètre au
Liban, il y a sur place 150 000 combattants de multiples factions locales,
Phalanges, Parti socialiste progressiste, Amal, Organisation de libération de
la Palestine, Hezbollah, etc., et de dix-huit nationalités, le tout sur un
territoire grand comme le département de la Gironde. À ce niveau d’interactions,
il est même possible que la situation ne soit plus complexe, mais chaotique,
échappant alors à toute possibilité de stratégie.
Une force multinationale dite d’« interposition »
puis de « sécurité de Beyrouth » (FMSB) s’ajoute encore à ce conglomérat à
partir de l’été 1982 avec des contingents américain, italien et français
afin d’aider le gouvernement libanais à sécuriser la capitale. Cette expérience
de la FMSB est finalement un désastre, et la faute en revient clairement à un
décalage flagrant entre la complexité de la situation et la pauvreté des
conceptions stratégiques et opérationnelles.
La fenêtre d’Overton désigne les idées que
des électeurs sont capables d’accepter dans un discours électoral. On peut
désigner de la même façon ce que l’exécutif politique croit acceptable par
l’opinion publique comme justification à l’emploi de la force et aux pertes
éventuelles. Cette fenêtre aura d’ailleurs tendance à se réduire au fur et à
mesure que l’action s’effectuera à plusieurs. La « fenêtre de justification »
de la FMSB était alors si réduite par l’obsession de montrer que l’on n’était
pas en guerre, qu’elle a rendu la Force totalement impuissante face à des
organisations et des États hostiles. Incapable de s’adapter, la FMSB est
repliée piteusement au printemps 1984. La France seule y a perdu en
dix-huit mois autant de soldats qu’en Afghanistan de 2001 à 2012 pour aucun
résultat, sinon une grande humiliation.
Masse critique, diplomatie et action
Il est pourtant possible pour une
puissance intervenante de réussir une opération complexe. En 2006, la guerre en
Irak est un problème à six corps, qui forment en réalité autant d’agrégats plus
ou moins unis : la coalition dirigée par les États-Unis, le gouvernement
dominé par les grands partis chiites, l’armée (chiite) du Mahdi, les groupes
armés sunnites nationalistes, l’État islamique en Irak (EII) et l’alliance
kurde. Pour les Américains l’urgence consiste à sortir honorablement de cette
situation. La rupture est obtenue par l’envoi de renforts, des méthodes
nouvelles, mais surtout par de la diplomatie locale. Les Américains acceptent
de s’allier avec leurs anciens ennemis nationalistes sunnites pour lutter
contre l’EII, le principal ennemi commun. L’armée du Mahdi se retirant
provisoirement des hostilités, la situation redevient alors un problème
compliqué et à deux corps : l’EEI et tous les autres. Avec une telle masse
critique, l’État islamique en Irak est réduit et presque détruit en 2008,
tandis que l’action de la cette « méga-coalition » se reporte sur l’Armée du
Mahdi qui accepte de déposer les armes. La guerre est finie pour un temps et
les Américains peuvent effectivement se retirer « en bon ordre » deux ans plus
tard.
En 2015, la guerre en Syrie est un
problème à quatre corps locaux : l’État et ce qu’il lui reste
d’instruments régaliens, la coalition iranienne, la disparate rébellion et
l’État islamique. À ces acteurs locaux, il faut ajouter Israël et la Turquie
qui interviennent régulièrement militairement dans le pays, les pays arabes
sponsors et enfin les puissances occidentales. On se trouve clairement en
présence d’une des guerres mosaïques parmi les plus complexes de l’histoire. Le
conflit dure, car il est plein de rétroactions. Chaque offensive victorieuse
d’un camp est en effet compensée immédiatement par un renfort qui rétablit
l’équilibre des forces.
Parmi les puissances extérieures, les
meilleurs résultats ont été obtenus par celles qui avaient un objectif unique
et clair : assurer la victoire du régime d’Assad, comme l’Iran et la
Russie, ou empêcher le développement de moyens d’attaquer son territoire, comme
Israël. La seconde condition de réussite a été l’engagement de moyens et une
prise de risques en accord avec cet objectif. Israël « punit » par des frappes
aériennes les acteurs qui n’ont pas le comportement qu’il souhaite et
franchissent les lignes rouges qu’il a indiquées. Cela influe peu cependant sur
le cours des événements internes.
La rupture locale est intervenue avec l’intervention
du corps expéditionnaire russe en septembre 2015 qui a permis au camp assadiste
d’atteindre la masse critique suffisante pour s’imposer. En sériant les ennemis
du plus près au plus loin, cette nouvelle coalition a réduit les situations
locales à des problèmes compliqués où le rapport de forces favorable, joint à
la possibilité de sorties négociées pour l’adversaire, a permis à chaque fois
de l’emporter. Chaque victoire a ensuite renforcé encore le rapport de forces
favorable et découragé progressivement les adversaires. Bien entendu, tout cela
a eu un coût, plus d’une centaine de soldats ou mercenaires russes tués à ce
jour, mais c’était un coût assumé pour l’atteinte d’un objectif jugé
important pour les intérêts et la sécurité de la Russie. Pendant ce temps, les
autres acteurs extérieurs occidentaux, turcs ou arabes, officiellement associés
ont combiné des objectifs différents et parfois opposés : renverser Assad,
détruire l’État islamique, promouvoir les groupes salafistes ou les Frères musulmans,
empêcher la constitution d’une entité politique kurde en Syrie ou au contraire
la protéger. Les moyens et les risques pris enfin n’ont pas été en accord avec
les objectifs.
Une bonne stratégie, quel que soit le degré de complexité d’une opération, consiste toujours en la bonne combinaison entre un objectif, des moyens et des modes d’action. La différence est qu’entre les moyens et l’objectif, il n’y a qu’une voie possible dans les opérations simples, qu’il faut choisir la bonne dans les compliquées, qu’il faut en construire une à force de volonté et d’intelligence dans les complexes et attendre d’y voir plus clair lorsqu’on est face au chaos.
Une bonne stratégie, quel que soit le degré de complexité d’une opération, consiste toujours en la bonne combinaison entre un objectif, des moyens et des modes d’action. La différence est qu’entre les moyens et l’objectif, il n’y a qu’une voie possible dans les opérations simples, qu’il faut choisir la bonne dans les compliquées, qu’il faut en construire une à force de volonté et d’intelligence dans les complexes et attendre d’y voir plus clair lorsqu’on est face au chaos.
Ce modèle est inspiré du modèle Cynefin de Dave Snowden. Pour une bonne
description de Cynefin voir Cynthia F. Kurtz, David J. Snowden, “The new
dynamics of strategy: Sense-making in a complex and complicated world”, IBM
Systems Journal, Vol. 42, N° 3, 2003.